Or le mantra « ajouter de la vie aux années plutôt que des années à la vie » n’est pas récité que par les vendeurs de pilules miracles et autres cures de jouvence — pourtant nombreux. La science s’y intéresse de plus en plus, pour les évidents avantages qui en découleront du point de vue du bien-être, de l’intégration sociale et de l’économie. Travailler dans l’anticipation à reculer toujours plus l’entrée dans la sénescence (entendue ici comme le moment où la qualité de vie baisse significativement et le besoin de traitements augmente) et raccourcir la durée de cette phase entre la fin de la bonne santé et la mort paraît s’imposer comme la plus sensée des démarches.
Car le vieillissement de la société entraîne avec lui tout un chapelet de questionnements profonds. Cela va du poids économique des aînés sur les actifs à des questions urbanistiques ou architecturales, de la redéfinition du rôle de chacun en fonction de son état de santé à l’irruption d’assistants robotiques pour les personnes âgées, jusqu’à la question, éthiquement vertigineuse, d’une « date limite » à l’existence humaine.
- Intercepter les maladies avant leur survenue
- Les souris, modèles indispensables pour comprendre le vieillissement
- Des recettes pour espérer gagner quelques années
- La technologie pour accompagner la perte d’autonomie
- Avantage aux femmes
- Dis-moi où tu habites, je te donnerai ton espérance de vie
- En finir avec l’âgisme
- «L’être humain, quand il aime, quand il vit une vie sensée, a envie que cela dure toujours!»
Nous ne sommes pas tous égaux devant le vieillissement. Prédispositions génétiques, facteurs environnementaux, comportement et alimentation sont les principaux critères qui auront une influence sur la qualité des années qui passent — et la survenue ou non de maladies liées à l’âge. «Il convient de distinguer l’espérance de vie (lifespan) et la durée de vie en bonne santé (healthspan), tranche d’emblée Johan Auwerx, directeur du Laboratoire de physiologie intégrative et systémique (LISP) à l’EPFL. Le développement de certains traitements, par exemple contre les cancers, permet bien sûr de prolonger la vie. Mais cela tend à faire augmenter surtout la durée de la phase qui s’étend entre la fin de la bonne santé et la mort. En Europe, l’espérance de vie moyenne est de 79 ans mais le healthspan moyen est de 68 ans. Or ces 11 années-là — et particulièrement la dernière — sont les plus problématiques, tant pour la qualité de vie de ces personnes et de leur entourage que pour les coûts qu’engendrent les soins nécessaires, en général à la charge de la société via le système des assurances.»
Ce constat a de quoi bouleverser l’état d’esprit de la recherche médicale. «Nous sommes encore très ancrés dans un modèle où l’on cherche à développer des médicaments pour traiter une maladie une fois qu’elle est déclarée, reprend Johan Auwerx. Or nous disposons aujourd’hui d’outils que nous pouvons utiliser afin d’agir en amont, d’intercepter les maladies avant qu’elles ne surviennent. En termes de qualité de vie et de coûts, c’est très clairement une bonne opération.»
Les approches pour atteindre cet objectif sont multiples. Les plus sérieuses, fondées sur la science, cherchent à comprendre non seulement ce que signifie vieillir, mais aussi et surtout ce qui peut favoriser la survenue de maladies. «Même les analyses d’ADN commerciales, qui ne coûtent qu’une poignée de dollars, sont en mesure de repérer certaines prédispositions génétiques à des problèmes susceptibles d’arriver avec l’âge, poursuit Johan Auwerx. En avoir connaissance peut favoriser la prévention, dans une approche véritablement personnalisée.» Et de citer l’exemple de l’actrice Angelina Jolie, qui a procédé préventivement à une double mastectomie et une ovariectomie suite à la découverte d’un gène défectueux.
Dans de nombreux cas, les prédispositions mises en lumière par la génétique ne sont pas aussi graves, mais peuvent donner l’assise à diverses mesures de prévention. Une grande étude menée en Iran (PolyIran, publiée dans The Lancet en 2019) a montré que la prise de médicaments classiques et bon marché, faiblement dosés et administrés de façon ciblée à des patientes et patients dès l’âge de 40 ans, réduisait significativement les risques cardovasculaires et pouvait ainsi éviter aux patients de se retrouver, après 60 ans, à devoir ingurgiter quotidiennement des dizaines de pilules. «Cette surenchère de médicaments que l’on prescrit aux seniors — ce qu’on appelle polypharmacie — ça ne marche pas et ça n’est pas durable, déplore Johan Auwerx. Pourtant à partir d’un certain âge, c’est devenu la norme dans nos sociétés.»
Cette surenchère de médicaments que l’on prescrit aux seniors — ce qu’on appelle polypharmacie — ça ne marche pas et ça n’est pas durable.”
Un autre moyen d’intercepter les maladies avant leur survenue est d’adapter son comportement — et en particulier les habitudes alimentaires et l’exercice physique — qui joue un rôle de premier plan dans le prolongement de la durée de vie en bonne santé. Les statistiques sont claires : en moyenne, la santé se détériore rapidement dès le passage à la retraite. «La clé, c’est de rester actif, reprend le chercheur. Mais nous avons désormais les capacités qui nous permettent d’associer informations génétiques et données physiologiques en temps réel — obtenues via des montres ou autres capteurs connectés. C’est un domaine en pleine effervescence qui permettra d’intercepter de plus en plus de maladies avant qu’elles ne se déclarent et nécessitent des traitements.»
C’est dans cette optique que son laboratoire a lancé une importante étude des facteurs influant sur la longévité chez les souris — le Healthspan Diversity Project. En les comparant à des études de cohortes de patients, les chercheurs espèrent pouvoir transposer une partie de leurs découvertes à l’espèce humaine.
L’étude du healthspan humain n’en est qu’à ses débuts, mais intéresse de plus en plus de scientifiques. La première question à résoudre sera celle de sa définition : à partir de quelles conditions déclarera-t-on qu’on l’a dépassé et qu’on entre dans la sénescence ? Existe-t-il un retour possible, une prolongation de la vie en bonne santé même après un épisode de maladie ? Et s’il venait à être vraiment prolongé, faudrait-il que cela entraîne une nouvelle réflexion sur l’âge de la retraite ? À ces questions et à d’autres encore il faudra répondre avec toujours plus d’acuité dès lors que la proportion de seniors augmentera dans nos sociétés.
La vieillesse est-elle une maladie ?
Sauf accident, le vieillissement touche tout le monde. Pour autant, sa définition ne fait pas l’objet d’un consensus auprès de la communauté scientifique. Il y a 10 ans, un article publié dans
la revue Cell établissait des critères, au nombre de neuf, supposés donner les outils permettant d’observer les mécanismes de vieillissement et de le «mesurer».
En janvier de cette année, les auteurs ont mis à jour ces hallmarks of aging, les portant au nombre de douze : instabilité génomique, attrition des télomères, altérations épigénétiques, perte de protéostase, macroautophagie désactivée, détection dérégulée des nutriments, dysfonctionnement mitochondrial, sénescence cellulaire, épuisement des cellules souches, altération de la communication intercellulaire, inflammation chronique et dysbiose. «Chacune de ces marques doit être considérée comme un point d’entrée pour toute exploration du processus de vieillissement, ainsi que pour le développement de nouvelles thérapies anti-âge», expliquent les auteurs.
S’ils comportent l’avantage de pouvoir objectiver certains phénomènes, ces critères n’ont pas valeur de référence absolue et tendraient, selon Johan Auwerx, à séparer des indications qui devraient être considérées ensemble. «Le vieillissement, c’est avant tout une dégradation générale de toutes les fonctions biologiques», estime-t-il.
Certains chercheurs plaident pour considérer le vieillissement lui-même comme une maladie afin de pouvoir lancer des études cliniques pour le ralentir. C’est le cas par exemple du Français Jean-Marc Lemaitre, de l’Inserm, qui dans une récente tribune déclarait que l’on pourrait «traiter» le vieillissement, entre autres via des approches de reprogrammation de cellules sénescentes en cellules souches.
«Pour pouvoir traiter le vieillissement avec des médicaments et de petites molécules, il faut pouvoir le considérer comme une maladie, ce qui n’est pas encore le cas et pose problème aux médecins», explique-t-il.
Mais «soigner» le vieillissement ou le prévenir avec des médicaments est-il éthiquement acceptable ? Selon Andrew Steel, auteur de Ageless : The New Science of getting older without getting old, il n’y a pas de raison de se priver de développer des thérapies anti-âge : «Pourquoi ajouter quelques années supplémentaires sans crise cardiaque, sans cancer et sans fragilité ôterait-il du sens à la vie moderne ?» s’interroge-t-il.
Nous disposons aujourd’hui d’outils que nous pouvons utiliser afin d’agir en amont, d’intercepter les maladies avant qu’elles ne surviennent.”
Pas facile, à première vue, de saisir la ressemblance entre l’être humain et la souris. Pourtant, ce petit rongeur a permis et permet encore aux scientifiques de faire de grandes découvertes dans le domaine biomédical. Les plus de 90% de gènes que nous avons en commun peuvent suffire à comprendre certaines grandes règles du fonctionnement de notre organisme et de ce qui peut entrainer sa détérioration. C’est pourquoi la souris s’avère un modèle indispensable pour aborder l’un des phénomènes les plus complexes de la biologie : le vieillissement.
«Il n’est pas possible d’étudier le vieillissement naturel dans une population humaine. Il faudrait suivre, par exemple, tous les enfants nés en Suisse pendant 70 ans et analyser ces données. Sans parler des aspects éthiques et financiers d’un tel projet, les scientifiques ne disposent que de 35 à 40 ans de temps de recherche productive, ce qui n’est pas suffisant», explique Johan Auwerx, directeur du LISP à l’EPFL. Il a fait le choix de combiner des données génétiques issues d’organismes modèles comme la souris, dont l’espérance de vie avoisine les deux ans, avec des données humaines, pour chercher les points communs exploitables.
Son équipe a ainsi lancé en 2018 l’une des études les plus novatrices dans le domaine de la longévité, le Healthspan Diversity Project. «Nous essayons de trouver les gènes qui sous-tendent le déclin plus rapide, chez certains humains, de l’espérance de vie en bonne santé», continue le professeur.
Un «atlas» des causes génétiques possibles
Pour imiter au mieux la diversité génétique humaine, l’une des multiples raisons qui fait que nous vieillissons différemment, les scientifiques ont travaillé avec 82 souches différentes de souris, une approche peu orthodoxe dans le milieu de la recherche biomédicale, qui tend à uniformiser les modèles pour éviter la variabilité des résultats. 4500 souris — sans compter l’élevage — ont été nécessaires. «Le travail a principalement constitué, d’un côté, à observer les souris avec beaucoup de précision, pendant 20 mois (l’équivalent de 70 ans chez l’humain), grâce à un système digital de collecte de données 24/7 dans leur cage, et à faire un bilan cardiaque, métabolique et neurologique complet deux fois dans leur vie. D’un autre côté, nous avons procédé à des prélèvements pour générer une banque de données de 120’000 tissus», présente Maroun Bou Sleiman, collaborateur scientifique au LISP. Dans les salles d’opération du Centre de phénogénomique de l’EPFL, les techniciens du laboratoire ont procédé à l’euthanasie de souris à plusieurs âges et au prélèvement de 27 tissus sur chaque animal (foie, cœur, muscles, reins, yeux…), afin de les transformer en données exploitables et produire un «atlas» des causes génétiques possibles des variations de la longévité chez le rongeur.
Le Healthspan Diversity Project entre désormais dans une phase d’analyse, la plus importante, car c’est celle qui permettra d’associer les données murines à l’être humain. «On a séquencé le génome des souris, maintenant il va nous falloir générer des données multiomiques pour chaque tissu, c’est-à-dire l’ARN, les protéines, les lipides, etc. — des milliers de points pour reconstruire le domaine des possibles de la souris dans le vieillissement et connaitre les trajectoires qu’elle peut prendre aux niveaux clinique, physiologique et moléculaire. Ça n’est qu’un début, aussi énorme soit-il, qui pourrait nous permettre de l’intégrer aux êtres humains», prévoit Maroun Bou Sleiman.
Nous essayons de trouver les gènes qui sous-tendent le déclin plus rapide, chez certains humains, de l’espérance de vie en bonne santé”
Ces données seront comparées à celles, très importantes, des génomes de centaines de milliers de patientes et patients enregistrés dans des bases de données cliniques servant à étudier les contributions de la prédisposition génétique au développement de maladies. «Nous avons déjà fait des découvertes, comme le fait que la réduction des lipides céramides dans les muscles vieillissants prévient la perte musculaire liée à l’âge ou sur la réponse au stress mitochondrial, qui contribue à la fragilité des os», précise Johan Auwerx.
Prédire la trajectoire de vieillissement
L’équipe est actuellement en recherche de financement pour poursuivre ces importants travaux d’analyse, qui s’avèreront très couteux vu le nombre de tissus collectés. Les chercheurs soulignent qu’il y a urgence, car les tissus conservés dans des congélateurs vieillissent chaque jour, mettant en péril la collecte des données. «La moitié du travail est déjà faite, mais ce sera un gaspillage d’argent et des vies des souris si nous n’en tirons pas plus de bénéfices pour les humains», prévient Johan Auwerx.
Une difficulté vient du fait que la question scientifique, aussi importante soit-elle, est encore trop fondamentale, trop ambitieuse pour les grands groupes pharmaceutiques. Pourtant le principe, novateur ici encore, de détection des prédispositions d’origine génétique ou moléculaire de chacun, pourrait aider à prédire, en partie, la trajectoire de vieillissement ou de santé, et à détecter les problèmes éventuels avant qu’ils ne surviennent.
La moitié du travail est déjà faite, mais ce sera un gaspillage d’argent et des vies des souris si nous n’en tirons pas plus de bénéfices pour les humains.”
À lire les titres de presse, la vie éternelle est à notre portée. Enfin presque. Les méthodes (plus ou moins) scientifiques pour prévenir le vieillissement, rester jeune, régénérer nos cellules ou nos neurones, gagner quelques années foisonnent. Si la seule recette prouvée est liée au mode de vie, la quête de la pilule miracle se poursuit. Des pistes prometteuses existent, mais pour l’heure les seuls êtres qui ont le plus de chances de voir leur vie rallongée restent… la souris, le poisson-zèbre, la mouche ou le ver de laboratoire.
Je suis ce que je mange
On sait qu’un des piliers de la bonne santé est l’alimentation. Mais quand il s’agit de savoir quel aliment manger, comment le cuisiner et sous quelle forme, il devient impossible de trier le bon grain de l’ivraie. «La démonstration scientifique est difficile en matière d’alimentation, car l’alimentation n’est qu’un des éléments dans l’ensemble de nos comportements et des facteurs génétiques et environnementaux qui influencent notre santé», explique Christian Nils Schwab, directeur de l’Integrative Food and Nutrition Center de l’EPFL. En outre, il constate que du fait d’un manque de connaissances scientifiques fondamentales il est encore débattu de savoir si certains aliments — café, vin, lait… — sont bons ou mauvais pour notre santé. A fortiori, savoir s’ils ont des vertus ou des effets négatifs en matière de vieillissement est encore plus difficile à établir.
«Il existe évidemment certains consensus concernant par exemple les protéines végétales, les légumes ou autres, mais ils sont principalement le résultat de constats empiriques et non de démonstrations scientifiques», souligne Christian Nils Schwab.
Pourquoi si peu de certitudes ? «Parce que la recherche se focalise essentiellement sur la thérapie et que l’on néglige la prévention. Quand on pense métabolisme, on pense dysfonctionnement et thérapie. Mais la prévention offre des opportunités de recherche formidables pour les sciences de la vie. Notamment comprendre comment notre métabolisme fonctionne pour se donner les moyens d’un vieillissement en bonne santé.»
On voit toutefois émerger aujourd’hui la «nutrition de précision», qui associe la génétique et les comportements individuels à la nutrition et la santé. Contrairement aux approches universelles du type pyramide alimentaire qui donnent des informations génériques, la nutrition de précision tient compte des spécificités individuelles. Christian Nils Schwab y croit et est certain que la science peut apporter les outils et les plateformes pour y parvenir, pour autant que l’on change de paradigme et que l’on pense en termes de prévention et non uniquement en termes de réparer les conséquences. «Aujourd’hui pour un franc dépensé dans la nourriture, il en faut deux pour traiter ses effets négatifs pour la santé et l’environnement», rappelle-t-il.
Aujourd’hui pour un franc dépensé dans la nourriture, il en faut deux pour traiter ses effets négatifs pour la santé et l’environnement.”
Recycler ses mitochondries
Privées de leur force vitale, les cellules se ratatinent. Or c’est d’un organite particulier, la mitochondrie, qu’elles tirent leur énergie. Des recherches au long cours menées à l’EPFL par les équipes de Johan Auwerx ont pu démontrer que le processus de renouvellement des mitochondries au sein des cellules tend à se péjorer avec l’âge. Dans la foulée, les scientifiques ont identifié plusieurs facteurs favorisant ce recyclage — et en particulier le rôle de l’urolithine A, une molécule postbiotique fabriquée dans l’intestin à partir de certains phénols présents naturellement dans des fruits tels que la grenade, les baies et les noix. Problème : 40% seulement des humains ont un microbiome permettant de la synthétiser efficacement, et nul ne peut connaître son taux de conversion — soit la dose d’urolithine dérivée de l’alimentation. D’où l’idée de produire la molécule en laboratoire et de la proposer en tant que complément alimentaire. Des essais cliniques ont montré des effets mesurables de l’urolithine A sur la santé musculaire des patients. La spin-off Amazentis, basée à l’EPFL, la commercialise sous la marque Mitopure, protégée par des brevets dans plusieurs pays à travers le monde, et espère permettre à des millions de personnes de vieillir en meilleure santé.
Plus récemment (publications dans Nature Aging et Science Translational Medicine en 2023), le laboratoire de Johan Auwerx a également montré que l’accumulation d’un type d’acide gras particulier (les céramides) dans les cellules musculaires était dommageable au renouvellement de leurs mitochondries et que des traitements visant à freiner la production de ces céramides favorisaient la reprise du recyclage de ces «usines énergétiques cellulaires», améliorant ainsi la santé musculaire et la longévité chez les souris.
Reprogrammer les cellules
Alors qu’il cherche à comprendre comment les cellules souches embryonnaires sont capables de devenir n’importe quel type de cellule dans un corps fini, Shinya Yamanaka découvre l’inverse : comment reprogrammer une cellule adulte différenciée afin qu’elle redevienne pluripotente, c’est-à-dire comme au stade embryonnaire. La recette qui lui vaut le Prix Nobel de médecine en 2012 est (relativement) simple. Il suffit d’ajouter à une cellule adulte quatre facteurs de transcription — qui régulent l’expression des gènes — et un facteur de réactivation pour qu’elle devienne une cellule souche pluripotente.
L’idée n’est pas de reprogrammer toutes nos cellules — on en perdrait notre cerveau ! — d’autant que le taux de succès ne dépasse pas 1%, mais bien de remonter un peu l’horloge du développement. Des études, chez la souris, montrent que l’injection de « acteurs Yamanaka» entraine un rajeunissement des cellules et une régénération des tissus cellulaires. Toutefois, le défi est de trouver le bon équilibre, car certains essais se sont soldés par le déclenchement de cancers. À l’heure actuelle, cette méthode relève encore largement de la science-fiction. D’autant que régénérer des cellules de peau ou de rein d’une souris ne permet pas encore de dire qu’elle vit plus longtemps.
Néanmoins, c’est sur ce cheval qu’ont misé des milliardaires de la Silicon Valley, à commencer par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos. Il a lâché des millions pour financer la start-up Altos Labs, créée en 2021, dont le capital atteignait un record de 3 milliards de dollars en janvier 2022. Assez mystérieuse, avec pour mission de restaurer la santé et la résilience des cellules par le biais d’un programme de rajeunissement cellulaire, Altos a pour l’heure réussi à attirer quelques grands noms du domaine, à commencer par Shinya Yamanaka en tant que conseiller scientifique.
Comment reprogrammer une cellule adulte différenciée afin qu’elle redevienne pluripotente, c’est-à-dire comme au stade embryonnaire.”
Détournement de posologie
On découvre parfois un effet secondaire inattendu à un médicament indiqué pour une tout autre cause. Et secondaire ne signifie pas toujours négatif. Diverses études ont ainsi montré qu’un médicament à base de metformine, l’antidiabétique le plus prescrit et sur le marché depuis 60 ans, avait un effet mesurable pour prévenir ou ralentir trois maladies liées au vieillissement : la démence, les maladies cardiaques et le cancer. La molécule atténue les caractéristiques du vieillissement en retardant le vieillissement des cellules souches, améliorant l’autophagie et la communication intercellulaire, modulant la fonction mitochondriale et protégeant contre les dommages macromoléculaires. On lui prête les effets bénéfiques de la restriction calorique sur l’espérance de vie. Un consortium américain souhaite lancer une vaste étude clinique sur six ans, impliquant 3000 personnes, baptisée Targeting Aging with Metformin (TAME) pour confirmer ces bienfaits. Mais elle bute encore sur la question du financement.
La rapamycine, un inhibiteur de la croissance cellulaire et un immunosuppresseur utilisé couramment comme traitement antirejet lors de transplantations, aurait les mêmes vertus de mimer les effets de la restriction calorique. Mais là encore seules les mouches à vinaigre et les souris en ont bénéficié de manière contrôlée. Les chiens commencent aussi à travers le Dog Aging Project.
On découvre parfois un effet secondaire inattendu à un médicament indiqué pour une tout autre cause.”
Revitaliser notre ADN
À mesure que nos cellules s’usent, d’autres les remplacent, par division cellulaire. Lors de ce processus, les chromosomes dans lesquels s’entortille notre ADN sont protégés à leurs extrémités par des télomères. Ils garantissent l’intégrité de notre patrimoine génétique. Le problème est qu’au fur et à mesure des divisions, les télomères se raccourcissent tant et si bien que la cellule arrête de se diviser, devient sénescente et finit par contribuer au vieillissement. Les télomères constituent donc un indicateur de l’âge biologique d’un individu par comparaison avec l’âge chronologique (calculé depuis sa naissance).
Heureusement une enzyme, la télomérase, est capable de reconstruire les petits bouts rognés par la division cellulaire, rendant en quelque sorte immortelles les cellules. Le problème est que, chez l’humain, la télomérase est active essentiellement pour les cellules germinales (qui produisent les spermatozoïdes et les ovules), les cellules souches (encore indifférenciées) et… les cellules cancéreuses.
L’utilisation de la télomérase est donc à double tranchant. Le défi est de trouver le moyen de rendre immortelles les cellules somatiques sans induire de cancer. Des recherches sur la souris se sont révélées prometteuses pour autant que l’on associe des mesures afin de réduire le risque de cancer. Toutefois, rien ne dit encore qu’il en serait de même pour l’humain et jusqu’à présent c’est davantage à la recherche contre le cancer qu’à la fontaine de Jouvence que contribue la télomérase. En revanche, plusieurs études ont montré qu’un mode de vie peu sain, une consommation excessive d’alcool ou le stress contribuent au raccourcissement des télomères.
Les recherches sur les télomères et la télomérase ont valu à Elizabeth Blackburn, Carol Greider et Jack Szostak le Prix Nobel de médecine en 2009.
Du sang jeune
«Qu’il y ait un jeune homme, robuste, plein de sang spirituel, et aussi un vieil homme, maigre, émacié, à bout de forces, à peine capable de conserver son âme. Que l’opérateur dispose de deux tubes d’argent s’emboîtant l’un dans l’autre. Qu’il ouvre l’artère du jeune homme, qu’il y introduise l’un des tubes et qu’il le fixe. Qu’il ouvre immédiatement après l’artère du vieillard et qu’il y introduise le tube femelle. Les deux tubes étant alors réunis, le sang chaud et spirituel du jeune homme se déversera dans le vieillard comme une fontaine de vie, et toute sa faiblesse sera dissipée.» C’est ce qu’écrit, à la limite de la satire, Andreas Libavius, médecin et alchimiste allemand, en 1615, sans toutefois l’avoir expérimenté.
Dans les années 2000, des chercheurs américains ont tenté l’expérience : ils ont fusionné le système sanguin de deux souris, l’une jeune, l’autre âgée, et ont constaté que cette dernière avait repris du poil de la bête tant en matière de muscle que de fonctionnement de ses organes, du cœur au cerveau. Ni une ni deux, des entreprises outre-Atlantique ont vendu du sang jeune. La start-up Ambrosia proposait ainsi des poches de plasma pour quelque 8000 dollars l’unité. En 2019, la Food and Drug Administration a mis fin à ces transfusions, arguant qu’il n’y avait aucune preuve clinique que le sang de jeunes donneurs a le pouvoir de soigner, ralentir ou prévenir le vieillissement.
Alors que le mythe de Dracula s’effondrait, des chercheurs ont creusé afin de mieux comprendre le mécanisme à l’œuvre. Une équipe de Columbia a pris le problème dans l’autre sens. «Une personne de 70 ans avec un système sanguin de 40 ans pourrait avoir une durée de vie plus longue», estime Emmanuelle Passegué du Département de génétique et de développement à Columbia. Son équipe est allée chercher du côté de la moelle osseuse, siège de la production de cellules souches sanguines. En observant le système hématopoïétique, les scientifiques ont constaté que l’âge entrainait une dégradation des tissus osseux du fait de molécules inflammatoires altérant la production de cellules sanguines. Or un médicament contre la polyarthrite rhumatoïde de type anakinra, couramment prescrit, a le pouvoir d’inhiber cette inflammation. Administré chez les souris tout au long de leur vie, il a montré des effets significatifs sur le rajeunissement des cellules souches sanguines. Reste à savoir quels seront les effets chez l’humain.
Une personne de 70 ans avec un système sanguin de 40 ans pourrait avoir une durée de vie plus longue.”
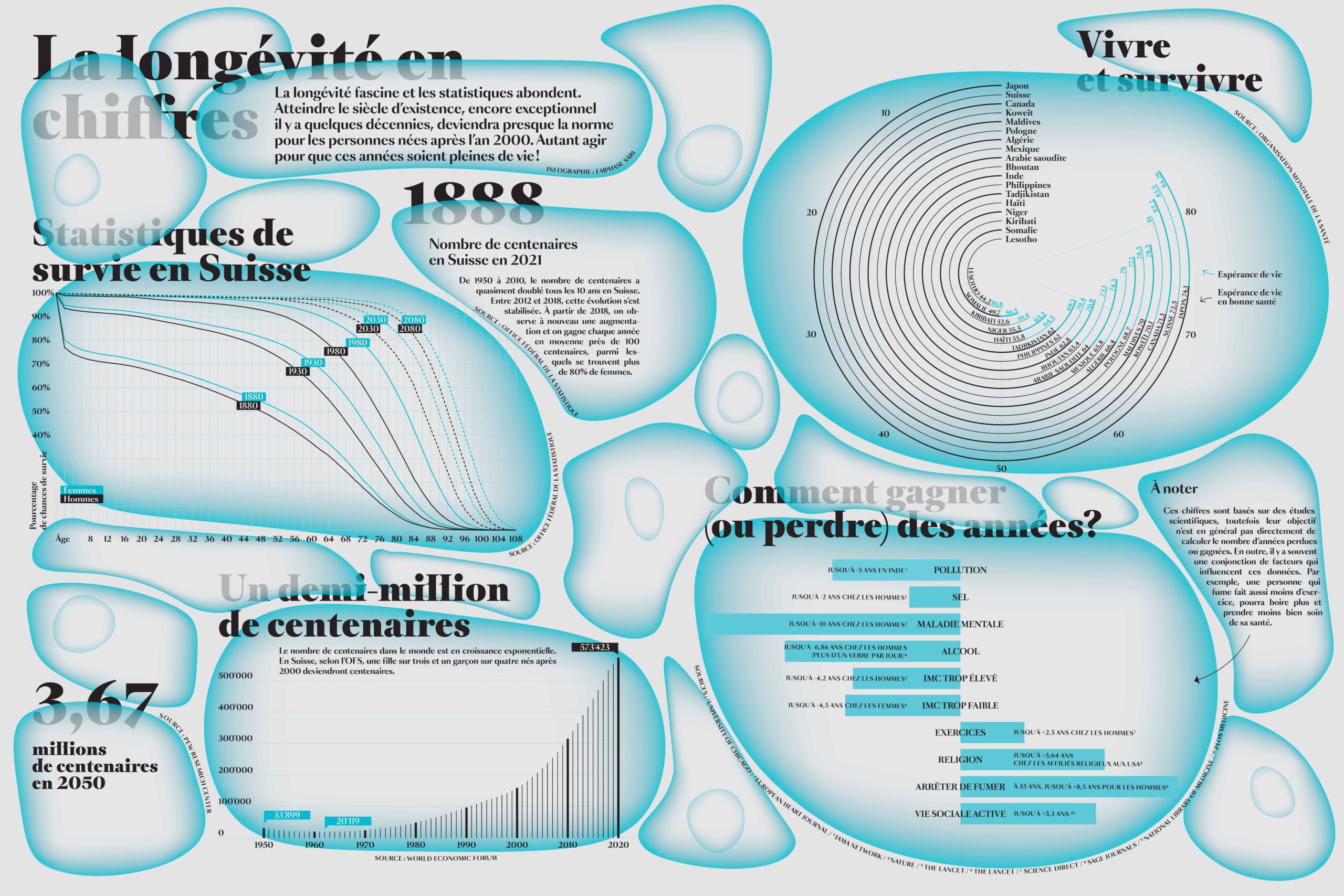
Purger les cellules zombies
Une autre piste soutenue par des milliardaires de la Silicon Valley est de débarrasser notre corps des vieilles cellules. Si nous vieillissons, c’est que nos cellules vieillissent. En principe, elles meurent, mais certaines, les cellules sénescentes, restent tels des zombies et s’accumulent dans notre corps. Leur présence a un effet délétère sur la fonction tissulaire en raison des nombreuses protéines qu’elles sécrètent, favorisant les maladies cardiovasculaires, les cancers et les démences. En 2015, une équipe de la Mayo Clinic dirigée par James Kirkland a découvert une nouvelle classe de médicaments, les sénolytiques, capables d’éliminer sélectivement les cellules sénescentes. Outre la recherche académique, plus d’une vingtaine d’entreprises de biotech drainent aujourd’hui des milliards en espérant commercialiser des médicaments. Toutefois, on n’y est pas encore. En 2020, Unity Biotechnology a stoppé ses essais cliniques en phase II, les sénolytiques n’ayant pas prouvé leur efficacité pour lutter contre l’ostéoporose. Par ailleurs, une étude publiée en octobre dernier dans Science avance que les cellules zombies n’auraient pas que des effets néfastes : elles s’intégreraient dans les tissus jeunes et sains et favoriseraient la réparation normale de tissus endommagés.
C’est d’abord un souhait : nous sommes une majorité à vouloir vieillir chez nous. «Seules» 15 personnes de plus de 65 ans sur 1000 résident en établissement médico-social (EMS). C’est aussi une réalité financière : les années d’autonomie coûtent moins cher — environ 5 fois — que celles passées en EMS. Et c’est également une opportunité financière : la silver economy, ou le marché prometteur lié à l’augmentation du nombre de seniors et leur pouvoir d’achat, pour des biens ou services qui correspondent à leurs besoins. Car avec l’âge il est presque impossible d’y échapper : notre santé se dégrade et nécessite une aide. «Vieillir chez soi ne signifie pas simplement rester à la maison, mais pouvoir se déplacer, faire ses courses et les tâches du quotidien», résume Delphine Roulet Schwab, professeure à la Haute École de la santé La Source et coresponsable du senior-lab, une plateforme interinstitutionnelle et interdisciplinaire d’innovation et de recherche appliquée.
Les soutiens, notamment technologiques, à une santé déclinante se multiplient : mesure de données physiologiques, capteurs d’alerte en cas de chute, fauteuil pour monter l’escalier ou robots d’aide, tout cela pour travailler sa mobilité, soutenir les personnes malades d’alzheimer ou analyser la démarche. «Autonomie 2020», un projet de gérontechnologie mené entre la Suisse et la France, liste des dizaines et des dizaines, qui mesure les paramètres physiologiques, les spin-off de l’EPFL Gait Up et son capteur pour détecter les chutes ou DomoHealth avec sa plateforme de coordination des soins, et bien d’autres en robotique, santé connectée, Internet des objets ou encore développement de capteurs. Et la demande pourrait être importante : selon un rapport du Canton de Vaud sur la silver economy, en 2019, les statistiques montrent non seulement que l’usage des technologies se répand rapidement, notamment chez les personnes âgées, mais aussi que la consommation directe générale des plus de 65 ans pourrait représenter 7 milliards de francs en 2040 pour le canton.
C’est d’abord un souhait: nous sommes une majorité à vouloir vieillir chez nous.”
L’e-autonomie, utile et avec ses limites
Quel impact a la technologie? «Elle fait partie des solutions, estime Delphine Roulet Schwab. Elle peut permettre à certaines personnes de rester plus longtemps chez elles, de décharger leurs proches, qui pourront s’investir plus longtemps. C’est lorsque ces technologies sont utilisées de manière systématique que cela peut générer des dérives. Il faut toujours mettre en balance leur plus-value et une possible atteinte aux droits fondamentaux.» Elle évoque par exemple un système pour localiser une personne au sein d’une institution. Est-il utilisé sur quelqu’un de désorienté quelques heures par jour ou sur tout le monde toute la journée ? «La technologie n’est pas la panacée. Les besoins des gens évoluent, on devrait pouvoir s’y adapter», ajoute la chercheuse.
Et parce que les besoins changent, elle estime nécessaire de réfléchir à de nouveaux modèles de prise en charge, plus flexibles. «Actuellement, face à une perte d’autonomie, il existe généralement deux possibilités : les soins à domicile ou le placement en EMS. On devrait concevoir des modèles évolutifs, adaptables, où les personnes paient pour ce qu’elles consomment. Mais cela demande de sortir des cases actuelles, en ne se basant pas uniquement sur le mode de financement, et donc de développer une innovation qui ne soit pas seulement technologique, mais un nouveau modèle économique et social.»
La technologie n’est pas la panacée. Les besoins des gens évoluent, on devrait pouvoir s’y adapter.”
Maison et santé connectée
Certaines technologies s’inscrivent dans ces moyens intermédiaires, comme les solutions de télésuivi, incluant la domotique et les dispositifs médicaux connectés. «L’une de nos offres s’adresse aux personnes dont la santé décline, pour qui la question du maintien à domicile se pose, explique Guillaume DuPasquier, diplômé de l’EPFL et fondateur de la start-up Domo-Health. Le but est de détecter et prévenir un problème grave — par exemple, éviter une chute sans intervention rapide, car on sait que cela péjore rapidement la situation — et transmettre au médecin des données en temps réel, comme la fréquence respiratoire, pour améliorer la prise en charge.» Des dispositifs médicaux connectés à domicile génèrent un profil en termes de sommeil, de mobilité ou d’habitude de vie quotidienne, et donnent l’alerte rapidement en cas de besoin. Quant aux données transmises aux médecins via un rapport mensuel, lu lors d’une consultation, elles permettent de personnaliser le traitement. «On voit ici l’importance de l’intelligence artificielle, qui peut analyser la masse de données, détecter les anomalies et faire des rapports succincts. Car les médecins n’ont pas le temps de regarder toutes les données», indique Guillaume DuPasquier.

Et le lien ?
Mais la technologie ne fait pas tout. «Nous avons besoin d’une réflexion globale, incluant les villes, les transports, la finance, la solidarité, le marché du travail, entre autres, et pas seulement de réflexions en silo, souligne Delphine Roulet Schwab. Prenez par exemple les personnes qui vivent dans des zones de villas, mal connectées aux transports en commun. Que se passera-t-il lorsqu’elles seront concernées par les restrictions d’utilisation du permis de conduire?» Les relations sociales jouent aussi un rôle important pour la santé : des études montrent par exemple que des contacts épanouissants diminuent le risque de développer certaines maladies chroniques en vieillissant.
Andrew Sonta, professeur assistant tenure track en génie civil à l’EPFL, estime justement que son domaine peut contribuer à s’attaquer à la solitude. Il note l’impact que peuvent avoir une ville ou des quartiers construits pour se déplacer à pied plutôt qu’en voiture. «Cela encourage une mobilité active et augmente les chances de provoquer des interactions sociales», souligne le scientifique. Il rappelle l’importance de la cohésion sociale et de varier l’utilisation des espaces — résidentiel, commercial, de travail — afin d’éviter par exemple des quartiers où les gens viennent uniquement pour travailler. «En cas de coup dur ou de situations liées au changement climatique, comme une vague de chaleur, les voisins et voisines seront probablement plus enclins à s’entraider dans un quartier où la cohésion a été rendue possible», indique le chercheur.
Cela encourage une mobilité active et augmente les chances de provoquer des interactions sociales.”
Comprendre les critères d’adoption
L’EPFL+ECAL Lab s’est également penché sur le sujet en menant une étude sur l’adoption du numérique chez les personnes de 65 ans ou plus. L’objectif était de mieux comprendre les critères d’adoption, pour développer une plateforme numérique adéquate, Resoli, destinée à renforcer le lien chez les seniors. «On connaît l’importance des contacts sociaux, aussi bien en termes de santé mentale que de santé physique, indique Nicolas Henchoz, directeur de l’EPFL+ECAL Lab. Mais pour développer des projets numériques qui soient adoptés, il faut comprendre les critères d’adoption des utilisateurs et utilisatrices.» L’EPFL+ECAL Lab a travaillé plusieurs années avec des seniors en collaboration avec Pro Senectute Vaud. «On s’est aperçu que lorsque les personnes nous disaient qu’un programme était trop «compliqué», c’était rarement une question de compétences, souligne Nicolas Henchoz. C’est simplement qu’elles ne voyaient pas la plus-value qui en aurait mérité l’utilisation.» Au lieu de simplifier à outrance et d’aboutir à une solution potentiellement stigmatisante, les designers ont identifié les principales barrières d’adoption chez les seniors — la confiance, la crédibilité et l’impact dans la vie réelle — afin de les surmonter. «Nous nous sommes aperçus que le résultat offrait également une meilleure solution pour une population plus jeune. Car les obstacles nommés par les seniors se retrouvent chez nous toutes et tous», observe Nicolas Henchoz.
On connaît l’importance des contacts sociaux, aussi bien en termes de santé mentale que de santé physique.”
D’abord, ce n’est en fait pas tant que les femmes vivent plus longtemps dans l’absolu ou vieillissent moins vite, mais plutôt que les hommes meurent plus jeunes. Ces messieurs ont en effet tendance à adopter des comportements plus risqués. Est-ce à cause de la testostérone, de leur lobe frontal qui se développe moins vite que chez ces dames ? Le résultat est qu’ils décèdent plus tôt au volant d’une voiture, à vélo ou en montagne, après un duel ou un suicide. En outre, ils seraient plus enclins à fumer, boire, être en surpoids, occupent des postes plus dangereux, vont moins chez le médecin et, quand c’est le cas, suivent moins bien leur prescription.
Le niveau élevé de testostérone aurait également pour effet de diminuer la fonction immunitaire et d’accroitre le risque de maladie cardiovasculaire. Inversement, les œstrogènes joueraient un rôle protecteur. Génétiquement, le chromosome Y aurait tendance à développer plus de mutations que le X et en outre leur X n’aurait pas de backup, comme chez les femmes.
Enfin, il est intéressant de noter que ce fossé entre les sexes n’existe pas seulement chez les homo sapiens, mais chez une majorité de mammifères. Une équipe menée par Jean-François Lemaître, chercheur CNRS au Laboratoire biométrie et biologie évolutive à l’Université de Lyon, a compilé des données démographiques de 134 populations de 101 espèces de mammifères, des chauves-souris aux lions en passant par les orques ou les gorilles. Dans 60 % des cas, les femelles vivent plus longtemps que les mâles : leur longévité est en moyenne supérieure de 18,6 % à celle des mâles (la différence n’est que de 7,8 % chez les humains). Élément intéressant, l’équipe internationale n’a pas trouvé de différences dans les taux de vieillissement entre les sexes. Les différences seraient principalement issues d’interactions complexes entre les conditions environnementales locales et les «coûts» de reproduction spécifiques au sexe.
Depuis 100 ans, la durée de vie augmente partout sur la planète. Hormis dans des contextes de guerre et quelques pays tels que les États-Unis, qui connaissent une baisse de l’espérance de vie du fait notamment de la crise des opioïdes. «Mais parallèlement, on observe un accroissement des inégalités de cet allongement, y compris au sein d’une agglomération», souligne Mathias Lerch, qui dirige le Laboratoire de démographie urbaine de l’EPFL. En d’autres termes l’espérance de vie n’est pas la même si l’on vit à la ville, à la périphérie ou à la campagne; dans un canton ou un autre. Aujourd’hui, un Genevois (81,9 ans) a deux ans et demi de plus d’espérance de vie qu’un habitant de Glaris (79,3 ans)…
Mais à y regarder de plus près, la réalité est un peu plus complexe qu’une durée de vie. Le laboratoire de Mathias Lerch s’intéresse à cette «géographie de la mortalité» dont le but est de mettre en évidence les facteurs à l’origine de ces écarts en distinguant structure, comportement et contexte. «Avant la révolution industrielle, la ville était un endroit où l’on vivait plus mal et moins vieux qu’en zone rurale du fait notamment de la circulation des épidémies, de la surpopulation et de la précarité du système sanitaire. Après la révolution industrielle, par des pratiques d’hygiène élémentaire, la situation s’est inversée. En revanche, depuis les années 60, en Suisse particulièrement, on constate une inégalité intra-urbaine de la mortalité. Ainsi les centres connaissent une mortalité plus élevée que les périphéries urbaines et semblable aux zones rurales», détaille le chercheur.
Le poids des facteurs environnementaux
Pour isoler le contexte de la mortalité, Mathias Lerch étudie un maximum des autres paramètres influents. Et ils ne manquent pas. À commencer par la composition sociodémographique. «Dès les années 60, les villes suisses ont connu ce phénomène de périurbanisation par lequel les gens quittent le centre-ville pour s’établir dans les périphéries moins congestionnées, explique le démographe. Ces mouvements sélectifs ont concerné essentiellement la classe moyenne supérieure, une population qui est mieux armée, en termes financiers et d’instruction, pour mener une vie plus saine. En outre, il s’agit souvent de familles, un facteur connu pour influencer positivement la longévité de plusieurs années. Parallèlement dans les centres-ville s’accumulent des facteurs psychosociaux défavorables. L’anonymat et le stress de la société urbaine, au sein de populations plus diversifiées, affaiblit notamment le lien social. Enfin, les aspects comportementaux induisent une occurrence supérieure du cancer par exemple dans les centres-ville, ce qui péjore l’espérance de vie.»
Les facteurs environnementaux pèsent aussi de leur poids. On le sait maintenant, la chaleur tue. Lors des canicules, la ville, plus dense et moins verte, connaît des températures de plusieurs degrés supérieures à la campagne. On le sait aussi, le bruit — particulièrement nocturne — affecte la santé, favorisant le stress et les maladies cardio-vasculaires, comme l’a confirmé une étude de l’EPFL, du CHUV et des HUG datée de 2018. Plus polluée, la ville encourage moins l’activité physique. La qualité du logement peut aussi exercer une influence par son isolation au bruit, à la chaleur ou sa vétusté. A contrario, la proximité d’infrastructures, y compris médicales, est un facteur favorable à une plus grande longévité.
Les comportements individuels ne sont pas étrangers à la durée de vie. En campagne par exemple, l’espérance de vie relativement moindre tient, selon le scientifique, à un taux d’accidents plus élevé ainsi qu’à une plus forte proportion des cancers, essentiellement dus à l’alcool. «C’est assez clair dans le Jura et en Valais, même si la différence tend à se tasser ces dernières années. On note aussi davantage d’accidents et de maladies cardiovasculaires, qui peuvent en partie être liés à l’accessibilité des soins et à une mentalité moins orientée vers la prévention.» Comme mentionné plus haut, la socialisation et la situation familiale sont également des facteurs déterminants d’où découlent des comportements plus sains. Tout comme les qualifications professionnelles, qui sont un facteur majeur. Un haut niveau d’éducation augmente l’espérance de vie de 7 ans à l’âge de 35 ans. En outre, «de manière générale, les différentiels de mortalité sont toujours plus marqués chez les hommes que chez les femmes, c’est aussi le signe que l’aspect comportemental est primordial dans ces différences — les hommes étant plus enclins à l’adoption de comportements à risque», souligne encore Mathias Lerch.
De manière générale, les différentiels de mortalité sont toujours plus marqués chez les hommes que chez les femmes.”
Une migration sélectionnée
Si les tendances sont claires, Mathias Lerch montre qu’il faut rester prudent quand on fait des recoupements géographiques. «Il est toujours difficile de savoir quand la personne a été exposée à son environnement le plus longtemps. Le lieu où la personne termine sa vie n’est pas forcément celui où elle en aura vécu l’essentiel. D’autant plus dans une société urbaine où les migrations sont importantes. Par ailleurs, faut-il prendre en compte le lieu de travail ou le lieu d’habitation ? Le premier peut présenter beaucoup plus de risques pour la santé que le second.»
En effet, la géographie de la mortalité est en constante évolution du fait des nombreuses migrations. «Aujourd’hui l’attractivité des banlieues est à nouveau très forte pour la classe moyenne et supérieure après un bref retour de l’attrait des centres-ville dans les années 2000, note le chercheur. On constate aussi que les populations qui le peuvent, souvent plus âgées, s’exilent en moyenne ou haute altitude lors des coups de chaleur. Une tendance qui va s’accroitre.»
Enfin, des facteurs externes peuvent contraindre les statistiques. Ainsi, les migrations externes ont un impact confirmé sur l’espérance de vie selon les régions, contribuant à l’accroitre dans les métropoles suisses, en particulier la métropole lémanique. Selon une étude publiée en 2018, l’espérance de vie s’y est accrue de 1,2 an chez les hommes et 0,6 an chez les femmes par la présence d’une population migrante sélectionnée. «On parle du phénomène de healthy migrant, car la sélection se fait dans le pays d’origine et ceux qui arrivent sont en général jeunes et en bonne santé, explique Mathias Lerch. Ensuite, on note ce qu’on appelle un «effet de saumon» car, après sa période active, souvent le migrant rentre au pays et y meurt. Le décès n’est donc pas enregistré en Suisse.»
Le lieu où la personne termine sa vie n’est pas forcément celui où elle en aura vécu l’essentiel.”
Il a fait sortir une partie de la France dans les rues, a divisé la Suisse lors de votations et reste un débat omniprésent face au vieillissement : le financement de nos retraites. Avec raison ? «Économiquement, pour les individus, c’est le facteur le plus important. Dans la majorité des pays, la pension est l’unique source de revenu, sauf pour les plus riches», indique Dorothea Schmidt-Klau, économiste et cheffe coordinatrice au Département des politiques d’emploi au sein de l’Organisation internationale du travail (OIT). Un facteur déterminant dans un éventuel passage vers la pauvreté, et qui concerne toute la population : un enfant né en Europe a aujourd’hui 50% de chances de vivre jusqu’à 100 ans, 19% de la population suisse était âgée de plus de 64 ans en 2021 et selon les Nations unies, la catégorie des plus 65 ans atteindra 1,6 milliard de personnes dans le monde en 2050.
Or au fur et à mesure du vieillissement, le taux de dépendance des personnes âgées (le nombre de personnes à la retraite pour chaque personne active), sur lequel le système de financement actuel est basé, se tend. «La part des cotisants et des cotisantes diminue, celle des bénéficiaires augmente, impactant les systèmes sociaux basés sur une solidarité intergénérationnelle. La Suisse devra s’adapter», admet Michel Oris, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université de Genève et ancien directeur du Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités. L’Office fédéral de la statistique (OFS) note qu’en 2019 la Suisse comptait 35 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes actives (moins de 3 pour 1) et qu’en 2050 il y aura 53 personnes de plus de 65 ans pour 100 actives (moins de 2 pour 1).
Pénibilité et espérance de vie en bonne santé très inégales
Pour s’adapter, quelles sont les options ? Le chercheur estime que modifier l’âge de la retraite en est une, mais parmi d’autres. Et qu’il faut surtout tenir compte de la pénibilité et des inégalités. «En Suisse, l’espérance de vie a beaucoup augmenté depuis l’instauration de l’AVS, mais pas l’âge de départ à la retraite. On peut donc y réfléchir», note le chercheur. Selon lui, il serait équitable d’augmenter l’âge de la retraite pour certains groupes sociaux et de le baisser pour d’autres, car tout le monde n’a pas le même nombre d’années à vivre à la retraite, encore moins en bonne santé. Les plus de 65 ans forment en effet un groupe très hétérogène, par leur formation, leur état de santé ou leur sexe. Si l’espérance de vie a augmenté en général, l’espérance de vie en bonne santé ou sans handicap grave n’est pas la même pour tout le monde. En se basant sur le niveau d’éducation, les études montrent que depuis le début du XXIe siècle, l’espérance de vie en bonne santé augmente continuellement pour les personnes avec une éducation tertiaire ou secondaire, mais stagne pour celles avec un niveau d’éducation bas, et de façon encore plus marquée pour les hommes. «Il faut également tenir compte des inégalités entre les hommes et les femmes, ajoute le socioéconomiste. Ces dernières vivent plus longtemps, mais avec plus de problèmes de santé.»
D’autres pistes existent aussi : Michel Oris cite par exemple les gains de productivité, source de revenu pour les collectivités, qui augmentent dans les pays riches (un travailleur ou une travailleuse rapporte de plus en plus). La Suisse est également un pays où les femmes travaillent beaucoup à temps partiel et possède donc un potentiel très important pour renforcer la population active. Et enfin, la migration : «Le profil des personnes arrivant en Suisse a beaucoup changé et correspond plutôt à des universitaires avec des qualifications manquantes sur le marché du travail suisse, indique le chercheur. Elles vont faire partie des personnes qui cotisent beaucoup.» Pour Dorothea Schmidt-Klau, il est essentiel de trouver le moyen d’augmenter le nombre de personnes actives pour contribuer au financement des retraites, notamment en incitant les personnes âgées qui le souhaitent, et le peuvent, à travailler un peu plus longtemps, en adaptant leurs conditions et leur environnement. «Cela peut également concerner les femmes ou les jeunes, des catégories où il y a encore un grand potentiel pour augmenter le taux d’activité», note l’économiste de l’OIT.
Dans la majorité des pays, la pension est l’unique source de revenu, sauf
pour les plus riches.”
Une productivité en baisse ? Changez de perspective !
Mais pour que cela fonctionne, un véritable changement d’esprit de la société est nécessaire. En effet, l’âgisme, ce traitement défavorable de l’âge, reste un facteur discriminatoire extrêmement présent, notamment sur le marché du travail : un personnel plus vieux est souvent perçu par les entreprises comme synonyme d’une baisse de productivité et de coûts plus importants. «Pourtant, en plus de l’expérience qu’une personne âgée apporte, des études montrent qu’en continuant à apprendre tout au long de notre vie, nous n’aurons pas plus de difficulté qu’une personne jeune à intégrer de nouvelles connaissances, note Dorothea Schmidt-Klau. Mais cela nécessite d’investir dans la formation à long terme.» L’économiste souligne également qu’intégrer plus de personnes âgées sur le marché du travail ne met pas en péril les places de travail des jeunes : ils n’ont pas le même profil, pas les mêmes compétences. «Et des études montrent le contraire : lorsque le taux d’emploi augmente chez les plus âgés ou chez les femmes, il augmente aussi chez les jeunes et les hommes. Si nous pouvons résoudre le problème de la pauvreté chez les personnes retraitées, nous agissons également au bénéfice des jeunes.»
Baby-boomers = apocalypse ?
Quant aux scénarios parfois dramatiques annoncés avec l’arrivée des baby-boomers à la retraite (cette génération née entre 1945 et 1964 quand la natalité a explosé), Michel Oris tempère : «L’effet de masse a créé une inquiétude, cela fait des années qu’on nous annonce une catastrophe. Pourtant, quand les baby-boomers sont allés à l’école, le système scolaire ne s’est pas effondré. Quand ils ont intégré le marché de travail, le taux de chômage n’a pas explosé. Cela fait des décennies qu’on nous fait la même prédiction. On ne peut pas prédire l’avenir de manière unilatérale.»
Autre scénario parfois bien pessimiste et lié au vieillissement de la population : l’augmentation des coûts de la santé et la pérennité du système actuel. Selon les chiffres de l’OFS, les dépenses de santé représentaient 11,8% du PIB en 2020, contre 8,8% en 1995, et 4,9% seulement en 1960. Si les dépenses sont en hausse, la fondation Promotion Santé Suisse souligne que les économistes de la santé mettent en garde contre l’équation affirmant que les dépenses de santé augmentent avec l’âge. Ce ne serait en effet pas l’âge, mais les années restant à vivre qui sont déterminantes dans le calcul du montant des dépenses de santé. La fondation cite une étude se basant sur des données suisses, démontrant que les besoins les plus importants en prestations de santé — et les frais élevés qui y sont liés — surviennent durant la dernière année de vie, quel que soit l’âge de la personne. Comme le relèvent également plusieurs acteurs , ce sont en grande partie les innovations technologiques qui font grimper les coûts du système de santé, ou, comme le note l’OFS, « une tendance de fond complexe constituée de plusieurs phénomènes, tels que le nombre de patients, le volume de soins par patient, le coût des prestations sanitaires, les conditions de vie stressantes, la désolidarisation entre les générations, etc.»
L’importance des années en bonne santé
Statistiquement, un plus grand nombre de personnes âgées signifie malgré tout une hausse des demandes de soins, qui augmentent lorsqu’elles sont en mauvaise santé, et surtout dépendantes. Le nombre d’années en bonne santé — et donc les politiques de promotion de la santé — peut avoir un impact notable sur les dépenses. Toujours selon Promotion Santé Suisse, plus de 11 milliards de francs pourraient être économisés en réduisant les dépendances.
Même écho chez Michel Oris. Ses recherches montrent en effet que les concepts de troisième âge (l’âge de la retraite, des loisirs et de la liberté) et de quatrième âge (les plus de 80 ans, concept refuge de toutes nos peurs, de la sénilité à la perte de l’autonomie) ne cachent pas des groupes homogènes, mais des parcours de vie tous différents. «Chez les personnes de 80 ans ou plus, quelques personnes vieillissent en forme, la plupart se fragilisent, c’est-à-dire restent capables d’assurer leur quotidien de façon autonome, et une grosse minorité, 45%, finit sa vie dans la dépendance. Il faut travailler pour retarder ce passage à la dépendance le plus possible.»
Le poids du vieillissement sur les rentrées fiscales est également soulevé par certains et certaines économistes. Dans les pays européens, la majeure partie des revenus de l’État provient, en plus des cotisations sociales, des impôts sur le revenu, les taxes sur les biens et services ou des impôts fonciers. Un changement dans la pyramide des âges peut les modifier : un moins grand nombre de personnes actives peut signifier moins d’impôts payés et une consommation de biens et de services différents. Pour Michel Oris, cette question est uniquement politique. «Des solutions existent pour combler ce manque, les partis de gauche les répètent sans relâche, indique le socioéconomiste. Depuis les années 1980, les transactions financières ne sont plus taxées, une grande partie de l’économie se situe hors fiscalité. Changer cela pourrait faire partie de la solution.»
Il faut arrêter avec ce discours des vieux qui coûtent cher. Nous vieillirons toutes et tous ensemble, nous sommes sur le même bateau.”
Nouvelles habitudes de consommation et opportunités
Les spécialistes s’intéressent aussi aux habitudes de consommation, différentes générations ayant différents besoins, moyens et envies. Les secteurs qui profiteront du vieillissement de la société, comme les soins, le tourisme, le domaine pharmaceutique, par exemple, seront également ceux où se créent des emplois et de la richesse. «Le vieillissement a toujours été considéré comme négatif, alors que la génération à la retraite dans les pays développés est plutôt une génération avec des moyens, note Dorothea Schmidt-Klau. Ils ont de quoi consommer. Si l’économie s’adapte et que la société réalise le potentiel que cela représente, cela changera complètement la perspective.»
Face à tous ces enjeux, dont la liste est loin d’être exhaustive, une solution se trouve peut-être dans le renforcement des liens et de la solidarité intergénérationnelle. «Il faut arrêter avec ce discours des vieux qui coûtent cher. Nous vieillirons toutes et tous ensemble, nous sommes sur le même bateau», conclut Michel Oris.
La médecine peut-elle prolonger la vie à tout prix?
L’objectif de la médecine n’est pas premièrement de prolonger la vie , mais de proposer des thérapeutiques en cas de pathologies et de soigner. Que cela puisse prolonger la vie, tant mieux! Encore faut-il que ce soit une vie «vivable», sensée, relationnelle, etc. Et là encore, il ne faut pas se tromper : c’est l’être humain qui est digne et qui est au centre de toute décision éthique, pas la vie en tant que telle. L’obstination déraisonnable en fin de vie représente un acharnement à maintenir la «vie» à tout prix mais presque tout le monde considère aujourd’hui cela comme une pratique insensée.
Pourquoi l’humain est-il en quête d’immortalité?
L’être humain, quand il aime, quand il vit une vie sensée, a envie que cela dure toujours ! Il est difficile de se résoudre à la mort d’êtres chers. Certains comme les chrétiens croient à la vie éternelle, c’est-à-dire à la vie avec et en Christ, dans l’Amour ressuscitant. D’autres comme les transhumanistes croient à l’amortalité ou à la possibilité d’un upload neurologique préservant de la mort (sauf accident ou suicide…). D’autres encore, et c’est la piste explorée par Shin Ha Kyun dans la série Yonder (octobre 2022), évoque la survie du souvenir. Mais les dernières paroles de Jae Hyun, le héros, sont très significatives : «Les souvenirs sont précieux parce qu’ils sont le reflet de moments qu’on ne peut vivre qu’une fois.»
Le recours au suicide assisté est-il une conséquence de l’allongement de l’espérance de vie, d’une société qui refuse de plus en plus la maladie?
C’est plus compliqué que cela. Dans la société technologique qui est la nôtre, on inculque par nudging le désir de contrôler totalement son existence, et l’on fait croire que cette autonomie individualiste totale est possible et réaliste… Pouvoir disposer de sa vie et donc recourir au suicide assisté en sont une conséquence. En réalité, comme je l’ai souligné dans mes écrits avec la notion de vulnérabilité, l’être humain est relationnel, il est poreux au meilleur (amour, amitié, parole échangée…) et au moins bon (mal, maladie, haine…). Il nous appartient comme société d’organiser le vivre-ensemble pour que chacun y trouve son compte et soit respecté dans sa dignité.





